L’étude de cas sur l’aménagement maraîcher révèle comment les bénéficiaires du Programme Alimentaire Mondial au Tchad s’approprient ces infrastructures pour renforcer leur résilience face aux défis climatiques. Comment ces pratiques innovantes transforment-elles la durabilité des communautés locales ?
Système d’exploitation
Structuration d’activités
C’est la culture intensive utilisant les espaces réduits avec la rotation et l’association de cultures. L’exploitation des aménagements maraîchers débute après les récoltes champêtres, et se poursuivent jusqu’au tarissement de la source d’eau. La période correspondant va d’octobre à février, dépendamment de la disponibilité de l’eau qu’il y a soit dans le bassin, soit dans les puits. Par la motopompe, l’eau est pompée du bassin de rétention ou du puits principal puis drainée par de canalisations pour être stockée dans de puits secondaires et de micro bassins. L’arrosage se fait manuellement par aspersion. Au cours d’une campagne, les exploitants cultivent successivement 2 à 3 fois sur un même espace.
PLANCHE DE PHOTOS N°8 : ÉQUIPEMENTS D’ALIMENTATION
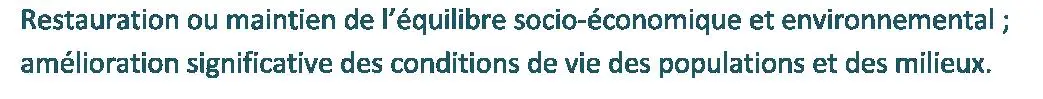

[17_img_3]
Drain maçonné micro-bassin arrosoir gradué Clichés Koutte Moussa, décembre 2017.
Un drain maçonné facilite la distribution de l’eau à travers le périmètre. Il permet de remplir les micro-bassins et les puits secondaires. Il permet également de réduire la perte d’eau par infiltration. Rares sont des sites qui sont équipés de ce type de drain. Les exploitants ont taillé des drains dans le sol pour compenser le manque de drains maçonnés.
Micro-bassin de stockage d’eau : disposés en plusieurs endroits à travers le périmètre, ils permettent de pallier aux difficultés de transport. Les exploitants se ravitaillent dans les micros-bassins. Car l’eau pompée du bassin principal et drainée à travers des canaux enfouillés ou à ciel ouvert pour remplir ces micro-bassins. La plupart de sites ne dispose pas de micro-bassins. Les exploitants font usage soit de puits secondaires, soit des excavations creusées par eux-mêmes pour pallier à cette insuffisance.
Usage d’arrosoir gradué : rares sont les exploitants qui disposent d’arrosoirs gradués et adéquats. Les exploitants font usage de récipients ou autres arrosoirs fabriqués localement pour faire l’arrosage.
Stratégies d’accompagnement
Après avoir appuyé la mise en œuvre des ouvrages de base, le PAM laisse la place aux ONGs locales qui continuent le travail d’accompagnement et de renforcement de capacités en apportant l’appui technique, des formations et des semences aux bénéficiaires.
TABLEAU N°7 : COUTS UNITAIRES DE PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
| Ouvrages et matériels | Coûts en FCFA |
| Bassin de rétention | 48.000.000 |
| Puits maraîchers | 1.000.000 |
| Clôture | 400.000 |
| Motopompe | 200.000 |
| Arrosoir | 7.500 |
| Total | 49607500 |
Source : Informations collectées sur le terrain, 2017
Compte tenu de la pauvreté économique, les communautés, à l’échelle d’un ou de quelques villages ne peuvent pas par eux-mêmes réaliser cet investissement.
Suivi technique des activités
Les agents des ONG partenaires suivent les exploitants sur le terrain en s’occupant de l’implication de représentants des exploitants dans les groupes de travail, de la formation des membres de CGA et de groupements sur les techniques de travail (compostage, traitement, production de semences, etc.) Les CEP et les visites d’échanges sont des lieux et de rendez- vous de ″donner et de recevoir″ entre les producteurs de différents sites.
PLANCHE DE PHOTOS N°9 : AGENTS SUPERVISEURS
[17_img_4]
Clichés Koutte Moussa, décembre 217.
Les superviseurs (de Moustagbal à gauche et d’APSE à droite) qui suivent les producteurs sur les sites d’exploitation. Ils veillent sur l’application des techniques de production et recueillent les doléances des producteurs.
Apprentissage et Visites d’Échanges sur les Champs-École-Paysans(CEP)
Les séances de formations sont organisées en faveurs des exploitants sur des sites d’apprentissage appelés Champs-École-Paysan. Pour pallier aux difficultés de déplacement, les ONGs qui assurent l’accompagnement des exploitants organisent de rencontres de formation sur le CEP. Les exploitants ou leurs représentants, issus de différents villages y sont conviés à recevoir de formations sur des techniques culturales précises. C’est également le moment où les exploitants s’échangent leurs expériences et leurs savoir-faire.
PLANCHE DE PHOTOS N°10 : CHAMP-ÉCOLE-PAYSANS
[17_img_5]
[17_img_6]
[17_img_7]
Clichés Koutte Moussa, décembre 2017
Dotation en semences
Les semences des légumes ordinaires telles que le gombo, l’oseille, la corète, etc. sont produites localement. Celles de légumes nouvellement introduites et celles qui sont chères telles que celles d’oignon et d’ail sont quelquefois offertes par les ONGs. Pour ne pas attendre l’offre des partenaires, les exploitants qui ont de moyens financiers, envoient acheter les semences à Mongo ou à Abéché.
TABLEAU N°8 : COUTS DES SEMENCES
| semences | Unité de mesure | Prix en FCFA |
| oignon | coro | 17500 |
| ail | coro | 5000 |
| gombo | coro | 7500 |
| tomate | verre | 500 |
Source : Informations recueillies sur le terrain, 2017
Apport et savoirs faire des bénéficiaires.
Comité de Gestion d’Actif (CGA)
Les exploitants ont mis sur pied des Comités de Gestion pour assurer le fonctionnement de leurs activités. Le Comité de Gestion d’Actif (CGA) est l’organe qui gère les activités, il convoque et dirige les réunions, il programme et organise les activités. En ce qui concerne les périmètres irrigués publics, c’est le Comité de Gestion qui s’occupe de tout ce qui concerne l’exploitation Il représente les exploitants et communique leurs besoins auprès des structures d’appui et d’accompagnement. Ils travaillent avec les agents des ONGs d’accompagnement pour les travaux de parcellisation et la formation.
TABLEAU N°9 : BUREAU EXÉCUTIF
| Noms et Prénoms | Fonctions |
| Halimé Bourma | présidente |
| Bouchira Adoum | Sécretaire générale |
| Achta Moussa | Sécretaire générale adjointe |
| Zara Tamour | Trésorière générale |
| Fatimé Issa | Trésorière générale adjointe |
| Achta Brahim | Chargée de communication |
| Tchasso Moussa | Chargée de matériel |
| Matérié Adoum | Conseillère |
| Haoua Guesha | conseillère |
Source : Informations recueillies sur le terrain, 2017.
Ressources de fonctionnement
Pour assurer les charges d’exploitation, les producteurs ponctionnent sur leur cotisation. Les cotisations servent pour les charges que sont : alimentation de groupe motopompe en carburant et sa maintenance en matériels de rechanges, curage de puits, achat de semences, etc. La cotisation se fait au démarrage des activités et pendant la période de récoltes, elle varie entre 100 FCFA à 200 FCFA par mois et par exploitant. Pour combler aux insuffisances financières, les exploitants creusent des puits complémentaires et ils fabriquent de puisettes et d’arrosoirs à base de bidons et de récipients.
Techniques de travail
L’activité est manuelle et l’essentiel du travail se fait avec les matériels aratoires, des instruments de bêchage et de puisage. Ce sont le débroussaillage avec la machette et la hache, le traçage de parcelles au moyen de piquets et de cendre, le creusage de planchées par la daba et la pioche, l’exhaure par la motopompe et les puisettes et l’arrosage manuel.
PLANCHE DE PHOTOS N°11 : TECHNIQUES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
[17_img_8]
[17_img_9]
Traçage de Parcelles Creusage de planchées
[17_img_10]
[17_img_11]
[17_img_12]
Bouse animale Fabrication du compost Amendement de planchées
Clichés Koutte Moussa, décembre 2017
Après avoir disposé les planchées, les exploitants y procèdent à leur amendement. Ils y font l’épandage de la bouse animale sur les planchées pour les rendre fertile et le paillage pour leur humidification. Il s’en suit le bouturage ou les semailles. Vient enfin l’arrosage progressif
PLANCHE DE PHOTOS N°12 : MATÉRIELS D’ARROSAGE
[17_img_13]
[17_img_14]
Aspersion manuelle par manque d’arrosoirs arrosoir de fabrication locale
Clichés Koutte Moussa, décembre 2017
Pour la bonne croissance des plantes, les exploitants veillent au traitement phytosanitaire pour prévenir ou libérer les cultures de l’attaque des ennemis de cultures. On procède aussi au désherbage.
PHOTO N°13 : MATÉRIEL DE TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE
[17_img_15]
Cliché Koutte Moussa, décembre 2017
Parlant de système d’alimentation, l’eau est drainée par des canalisations, mais elle est également apportée individuellement par transport au moyen de récipients, bassines et de puisettes.
PLANCHE DE PHOTOS N°14 : SYSTÈME D’ALIMENTATION
[17_img_16]
[17_img_17]
Exhaure motorisée par motopompe arrosage gravitaire avec canal et tuyau de dissipation
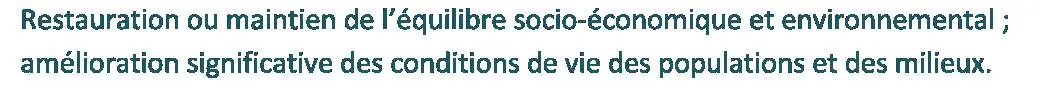


Puisettes de fabrication locale Puisage direct dans le bassin Puits de réalisation paysanne Cliché Koutte Moussa, décembre 2017
Pour l’alimentation, les motopompes permettent de pomper l’eau de puits principal ou de bassin de rétention vers les micro-bassins et les puits d’alimentation. Pour pallier le sous- équipement de périmètre, les exploitants pratiquent soit l’arrosage gravitaire grâce à la liaison motopompe-canal-tuyau (perforé) qui afflue d’eau les parcelles. Cette technique permet de pallier aussi les difficultés de transport. Des puits traditionnels sont aussi creusés par les exploitants pour compenser le problème de sous-équipement. Cependant, ces puits sont peu resistant et s’éboulent sous le coup des intemperies. Ils se bourrent de débris végétaux et de cailloux traînés par le vent et les eaux de ruissellement. Chaque année, les exploitants font d’abord le travail de réaménagement pour rendre fonctionnels ces types de puits.
Par manque de clôture en grille métallique, les exploitants adoptent la clôture en haie (morte) pour protéger leurs cultures et leurs ouvrages de l’incursion d’animaux errants.
PHOTO N°15 : CLÔTURE EN HAIE MORTE
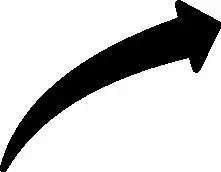
Cliché Koutte Moussa, décembre 2017
En conclusion, on notera qu’en optant pour les aménagements maraîchers, le PAM poursuit la vision du gouvernement de faire des aménagements hydroagricoles un moyen de valorisation des ressources, de la mobilisation et la responsabilisation des acteurs locaux pour la lutte contre la pauvreté. Ensemble avec les ONGs locales et les populations, le PAM a eu à réhabiliter de périmètres maraîchers existants et en a créé de nouveaux périmètres dans plusieurs localités du département du Guéra.
La qualité d’ouvrages a amélioré les conditions de travail et les rendements a aussi suscité et renforcé l’engouement pour le maraîchage de contre-saison. De leurs propres initiatives et moyens, les producteurs maraîchers réalisent d’ouvrages pour combler les insuffisances matérielles. Par leur organisation, ils arrivent à assurer certaines charges de fonctionnement. Malgré les insuffisances, les exploitants expriment à travers leur dynamisme la volonté de continuer le maraîchage de contre-saison.
Ainsi, nous verrons dans la partie ci-après les témoignages des exploitants pour leur participation aux différentes activités appuyées par les partenaires, et sur leur appréciation de l’impact de ces aménagements sur leurs conditions de vie. Après la discussion des résultats obtenus à partir des informations recueillies auprès des exploitants, nous avons fait de recommandations en faveur de l’exploitation durable des aménagements maraîchers réalisés.
