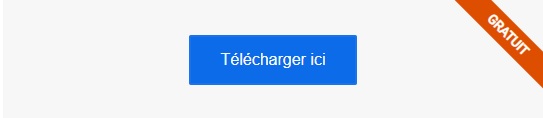2. Les actions médiatiques et les autres méthodes
C’est la quatrième étape de la stratégie de campagne. Greenpeace pour contester, organise des actions directes non violentes et médiatiques. Elle est fortement connue pour cela.
Sa grande liberté d’expression, en raison de son indépendance financière et politique, lui permet ce mode d’actions. C’est une forme de désobéissance civile, puisque l’association peut aller au delà de la légalité, mais toujours en faveur d’une cause légitime.
Sur son site Internet l’association se justifie : «Le cycle investigation, argumentation, information, concertation, devrait suffire, mais la plupart du temps il est indispensable de forcer le débat, d’obliger les acteurs à reconnaître leurs méfaits et d’imposer la prise en compte de certaines considérations environnementales.
Les actions de confrontation font la spécificité de Greenpeace et montre sa détermination à ne pas nous laisser faire.
La dimension médiatique et spectaculaire de ces actions est utilisée à dessein comme un moyen.»
Ainsi pour Truchet (2005 p 43) Greenpeace développe des «pseudo événements», terme de Jean Charron pour désigner «une action symbolique dont la raison d’être est la diffusion publique d’un message qui passerait difficilement la rampe sans le geste d’éclat qui l’accompagne».
C’est en quelque sorte comme une publicité pour eux.
Elle a accru sa notoriété dès 1975 avec sa lutte contre la chasse à la baleine à bord de zodiacs….Elle a en effet une force maritime avec trois grands navires (l’Arctic Sunrise, l’Esperanza, et le Rainbow Warrior II), la mer est son milieu de prédilection.
Pour Eric Dacheux, les bateaux de l’association constituent même une sorte de médias alternatifs, ils sont des portes paroles, des «bureaux itinérants d’information et de propagande» (1997, p195), permettant de relayer les campagnes ou les actions.
Cependant cela est très organisé.
Ces actions n’interviennent qu’à la fin, après des rencontres, des discussions quand les autres solutions ont été épuisées.
Bruno Rebelle l’explique : «les actions de confrontation ne représentent que 10 à 15% de notre temps de travail et absorbent 20 à 25% de notre budget» (cité par Antoine de Ravignan, 2003, p89).
Nadege Fréour (2004), explique que ce genre d’action rentre dans ce qu’appelle Eric Neveu, le répertoire d’actions de 3éme génération, que l’on a vu dans la première partie.
La mise en scène, le symbolique y est plus important que le nombre de manifestants.
Selon Vitral (2008, p 152), «Greenpeace est spécialiste dans l’étude des critères de newsworthyness (valeur d’information) à partir desquels les journalistes définissent les événements qui méritent d’être diffusés».
Pour Sylvie Ollitrault et Denis Chartier (2002), Greenpeace grâce à sa maitrise des moyens de communcation, de transport, peut agir simultanément à tout moment et n’importe où pour influer sur les décisions des instances internationales sans être limitée par des contingences spatiales ou temporelles.
L’organisation concrète de ces missions se fait dans le plus grand secret et en coordination avec plusieurs services.
Les militants activistes sont formés physiquement et psychologiquement pour avoir le comportement approprié face à la police et aux médias, pour savoir comment s’enchainer…
En effet Greenpeace a créé en 1995 aux Etats-Unis, la «Ruckus society», la société du chahut, pour préparer les mobilisations avec des ateliers, pour apprendre à escalader, à afficher des banderoles, à former des chaines humaines.
Elle donne des conseils juridiques ainsi que les bases du secourisme.
Ces militants de différentes nationalités sont au courant à la dernière minute de leur mission pour éviter des infiltrations et pour plus de surprise.
Ces actions sont véritablement mises en scènes pour permettre plus de médiatisation et de pression sur l’adversaire.
Le but est de faire éclater le scandale.
On a une vision manichéenne, David contre Goliath, le bien contre le mal, avec un adversaire bien précis, comme cible.
C’est la technique du «targeting», du ciblage, ou encore de l’étiquettage. Le principe est de définir un acteur comme déviant pour l’inciter à changer.
Ils utilisent le contexte, par exemple avant un G8, avant une réunion déterminante sur le sujet, avant des élections…
Les actions sont nombreuses et diverses, on peut citer un exemple récent.
L’exemple du nucléaire
Greenpeace a toujours été actif contre le nucléaire. En raison de son histoire, de sa naissance, ses premières actions sont liées au nucléaire.
Et la France a été une cible importante de Greenpeace.
On peut juste rappeler le fameux scandale du Rainbow Warrior en 1985 où les services secrets français font couler à Auckland le bateau de Greenpeace, qui manifestait contre les essais nucléaires à Mururoa.
Suite à ce scandale une campagne anti Greenpeace a lieu en France et le bureau Français de l’organisation est fermé de 1987 à 1989.
En 1987, la France versera 8 millions d’indemnités à Greenpeace.
De janvier à avril 2010 Greenpeace bloque des trains chargés de déchets nucléaires français qui partent de l’usine de retraitement de Tricastin en Drôme jusque Le Havre ou Cherbourg, puis sont exportés par bateau en Russie.
Les militants s’enchainent aux voies ferrées, aux portes des usines, affichent des banderoles «la Russie n’est pas une poubelle», ils manifestent aussi en Russie et en mer, les bateaux de l’association tentent de gêner ce traffic.
Des militants dans plusieurs villes ont aussi amené symboliquement leurs déchets devant les usines Areva et EDF.
Greenpeace demande un moratoire sur les exportations de matières nucléaires, et sur le site Internet on peut signer une pétition adressée à Jean Louis Borloo, ministre de l’Environnement et de l’Energie.
Il y a aussi plusieurs vidéos, une explicative avec des schémas, et une où une militante activiste lyonnaise explique les actions de Greenpeace et appelle au soutien de la population.
Cela personnalise le message.
Cette activiste envoie des messages régulièrement pour avertir des nouvelles actions. Fin mai, Areva décide d’arrêter prématurément le transport de ces déchets.
Un mail de Greenpeace rappelle toutes les actions de l’année.
L’ONG se félicite de sa mobilisation pendant toute l’année, relayée par la diffusion en octobre 2009, de l’enquête de Laure Noualhat et Éric Guéret, « Déchets : le cauchemar du nucléaire », cela a permis de relancer la polémique.
N’obtenant aucune explication satisfaisante de la part d’Areva, le ministre de l’Écologie et de l’Énergie a saisi le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire HCTISN qui a ouvert une enquête.
Greenpeace considère qu’exporter ces déchets en Russie est contraire à loi russe sur la protection de l’environnement datant de 1989 qui interdit les importations de déchets nucléaires.
Mais aussi à la directive européenne de 2006, relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.
Pierre Gleizes site de Greenpeace
Ce type de communication a permis d’importants succès à l’organisation, qui suscite une certaine crainte.
Ainsi des industriels préfèrent «prévenir que guérir» et se rapprocher de l’organisation.
C’est une communication qui est beaucoup plus réactive et efficace.
Ils peuvent sortir une campagne la veille pour le lendemain en raison de leur fonctionnement à l’anglo-saxonne pyramidale où l’exécutif a un pouvoir fort et n’est pas dépendant d’un Conseil d’Administration.
La capacité d’expertise
Les actions médiatiques ne suffisent pas. Greenpeace a beaucoup développé sa capacité d’expertise, pour proposer des alternatives, pour prouver ce qu’elle dénonce.
Pour cela elle a du faire appel à des personnes extérieures à l’organisation, des juristes, mais également des centres de recherches indépendants.
Pour être crédible et convaincante vis à vis des dirigeants, la seule sensibilisation ne suffit pas, elle doit avoir un message scientifique.
Mais vis à vis du grand public ce discours doit être vulgarisé un minimum pour être compréhensible.
Il faut pouvoir être pédagogue et expert simultanément.
Chartier et Ollitrault (2006 p 108) insistent bien sur les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et leur «rôle de traduction des problèmes environnementaux en un langage scientifico militant qui les légitime».
De même les médias sont attirés par les actions spectaculaires, originales, mais ils réclament aussi des arguments construits.
Ainsi comme nous explique Gérald Gallet (2002) l’expertise est devenue un outil de l’activisme environnemental hybride de Greenpeace.
Car celle ci apporte une crédibilité qui est nécessaire au préalable à tout activisme.
Cette nécessité peut expliquer en partie la professionnalisation de l’ONG mais fait émerger des conflits internes.
Car pour beaucoup la force de Greenpeace est dans sa différence avec les autres Organisations Non Gouvernementales (ONG), dans sa capacité à scandaliser, à réaliser des actions spectaculaires .
Les groupes locaux
Une autre forme de communication se réalise grâce aux groupes locaux que l’association possède dans toute la France et qui servent de relais des campagnes nationales.
Ils n’ont pas de statut juridique ni de ressources financières autonomes et sont fortement encadrés par le siège national.
Ils doivent s’aligner sur les campagnes, les méthodes, les supports de communication fournis par le bureau de Paris.
A l’opposé des méthodes managériales de ce dernier, les groupes locaux sont censés avoir une image plus artisanale, plus spontanée, pour incarner et mobiliser la société civile, développer un sentiment de proximité, prouver que Greenpeace est bien enracinée localement.
En effet c’est un moyen de montrer la légitimité de l’association, comme quoi elle est soutenue par des citoyens prêts à se mobiliser pour elle, à faire signer des pétitions, à distribuer des tracts, à tenir des stands d’informations…
La communication de Greenpeace a aussi évolué, plus professionnelle, plus institutionnelle.
Elle s’est éloignée des actions spontanées d’hippies pour devenir une «multinationale verte».
Cette évolution s’est renforcée avec l’arrivée au pouvoir de Greenpeace International de personnes venant du milieu de l’entreprise.
Thilo Bode en 1995 et Gerd Leipold en 2001. L’ONG a accepté son rôle non seulement de contestataire mais aussi de lobbying.
Thilo Bode affirme ainsi «nous sommes un groupe de pression politique, pas une association de randonneurs.
En faisant participer plus de personnes aux décisions, les buts de l’organisation seront rapidement pervertis» (cité par Antoine de Ravignan, 2003, p88).
Ainsi elle participe à des conférences internationales, elle a un bureau européen à Bruxelles, un poste d’observateur aux Nations Unies, elle a participé au Grenelle de l’Environnement.
3. Les limites et les critiques de la communication de Greenpeace
Avec cette évolution, l’image de l’organisation est brouillée, certains fondateurs ne se reconnaissent plus en elle, et des dissensions internes existent. C’est le cas de Bennett Metcalfe, (cité par Kohler, 2008) qui explique avoir «vraiment l’impression d’avoir créé un monstre, d’être un peu comme le docteur Frankeinstein».
Paul Watson un autre fondateur de Greenpeace a aussi quitté Greenpeace car il ne la trouvait pas assez radicale. Il crée ainsi une organisation dissidente, la Sea Shepherd en 1977, celle ci est plus violente concernant la lutte contre la chasse à la baleine, aux phoques, aux requins, aux dauphins.
Par son fonctionnement hiérarchisé, elle peut être vue comme non démocratique. Même si le directeur a beaucoup de pouvoirs, il ne doit pas faire de l’ombre à l’organisation globale. La communication ne doit pas être personnalisée autour de lui.
Adélaïde Colin3 nous explique que Greenpeace International est important, mais il reste un coordinateur qui supervise les campagnes communes, qui s’occupe de la flotte, qui centralise les informations et la communication, qui a un certain contrôle sur les bureaux.
Mais, les bureaux nationaux ont de l’autonomie, et ils peuvent s’exprimer à une assemblée générale annuelle. Certains bureaux ont plus de poids que d’autres, (Greenpeace Allemagne, Pays Bas, Royaume Uni, États Unis). Ayant plus d’adhérents, ils participent donc plus au financement de Greenpeace International et bénéficient de voix plus importantes.
Les groupes locaux sont beaucoup moins autonomes, ils ne peuvent pas décider de faire une campagne purement locale mais ils peuvent quand même avoir des initiatives. Cette structure est aussi justifiée dans un souci d’efficacité et de cohérence.
3 Entretien avec Adélaïde Colin, directrice de la communication de Greenpeace réalisé le 18 février 2010
Ensuite et cette critique nous intéresse plus car elle porte sur la communication, certains lui reprochent de manipuler les images et les faits. Yves Lenoir, ancien membre de Greenpeace explique que « Greenpeace peut créer de toute pièce une affaire à partir d’un dossier vide ». Il critique le fait que Greenpeace soit « une machine à faire du fric. A partir du thème de la survie de la planète, on organise des mises en scène, on filme, on médiatise à mort.
Et la monnaie suit » (cité par Olivier Vermont, 1997, p241). Un cinéaste islandais Magnus Gudmunsson, opposant zélé, a sorti un premier documentaire en 1989 Survival in the high North et un second en 1993 The Rainbow man . Dans lesquels il dénonce par exemple le fait que les scènes de chasse aux phoques filmées par Greenpeace sont truquées, mises en scènes et réalisées avec l’accord des chasseurs.