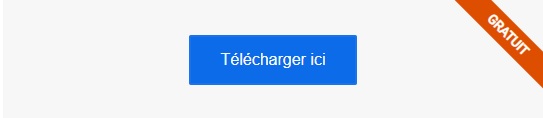Un « deuxième mouvement des enclosures »
Les défenseurs des biens communs s’appuient sur une deuxième lignée théorique, qui renvoie aux analyses historiques, économiques et politiques portant sur le mouvement des enclosures. Ils présentent ainsi les bouleversements contemporains du droit comme un « deuxième mouvement des enclosures », que James Boyle a nommé « l’enclosure des biens communs immatériels de l’esprit » (the enclosure of the intangible commons of the mind)2.
Le mouvement des enclosures se déroula en Angleterre à partir du XIIe siècle, mais surtout entre les XVIe et XVIIIe siècles. Il vit la transformation de champs ouverts, cultivés selon des méthodes traditionnelles et gérés de façon collective, en un système de propriété privée de la terre.
Il marqua la fin des droits d’usage sur les terrains communaux, dont de nombreux paysans dépendaient pour leur subsistance, et occasionna de ce fait un appauvrissement dramatique de la population rurale.
Il favorisa en revanche le développement de l’industrie et du commerce de la laine, en permettant aux propriétaires fonciers de s’approprier des terres pour l’élevage de moutons3. Dans L’Utopie, Thomas More a donné une description pathétique de ce qui était en train de se jouer sous ses yeux :
Ainsi donc, afin qu’un seul goinfre à l’appétit insatiable, redoutable fléau pour sa patrie, puisse entourer d’une seule clôture quelques milliers d’arpents d’un seul tenant, des fermiers seront chassés de chez eux, souvent dépouillés de tout ce qu’ils possédaient, circonvenus par des tromperies, ou contraints par des actes de violence. À moins qu’à force de tracasseries, on ne les amène par la lassitude à vendre leurs biens.
Le résultat est le même. Ils partent misérablement, hommes, femmes, couples, orphelins, veuves, parents avec de petits enfants, toute une maisonnée plus nombreuse que riche, alors que la terre a besoin de beaucoup de travailleurs. Ils s’en vont, dis-je, loin du foyer familial où ils avaient leurs habitudes; et ils ne trouvent aucun endroit où se fixer.1
1 Ce point est noté par Zaki Laïdi. Celui-ci relève que des libéraux aussi illustres que Thomas Jefferson, James Madison ou Adam Smith défendaient des droits de propriété intellectuelle strictement limités « au nom du libéralisme et du refus de voir se constituer des monopoles » [Zaki LAÏDI, « La propriété intellectuelle à l’âge de l’économie du savoir », Esprit, n°11, novembre 2003, en ligne : www.laidi.com/papiers/esprit1103.pdf (consulté le 26/10/2011)].
2 James BOYLE, The Public Domain, op. cit., p. 45. L’analogie avec le premier mouvement des enclosures est présente dans les écrits de nombreux auteurs américains, parmi lesquels James Boyle, Yochai Benkler, David Bollier, Ben Kaplan, Pamuela Samuelson ou David Lange. Elle est reprise en France, notamment par Philippe Aigrain, Hervé le Crosnier, Florent Latrive et Isabelle Stengers.
3 La thèse selon laquelle le mouvement des enclosures aurait été bénéfique économiquement a longtemps été incontestée. Elle a cependant été remise en question ces dernières années par plusieurs historiens, parmi lesquels Robert C. Allen. Ce dernier relativise ainsi les gains de productivité liés aux enclosures pour les terres qui ne furent pas transformées en pâturages, et il soutient de manière générale que le principal effet de la privatisation des communaux fut de changer la distribution de la richesse produite, bien plus que d’augmenter le volume de celle-ci (Cf. Robert C. ALLEN, Enclosure and the Yeoman. The Agricultural Development of the South Midlands 1450-1850, Oxford, Oxford University Press, 1992).
Karl Marx présenta lui le mouvement des enclosures comme une des causes de la révolution industrielle, permettant « l’accumulation primitive du capital » et occasionnant la migration vers les villes de contingents de paysans démunis qui fourniront la force de travail des industries naissantes. L’analyse la plus fameuse de cet épisode historique est néanmoins celle de Karl Polanyi.
Dans quelques pages magnifiques, qui ne sont pas sans rappeler par moments les descriptions de Thomas More, l’historien hongrois aborde les enclosures comme « une révolution des riches contre les pauvres », dévastatrice sur le plan social :
Les seigneurs et les nobles bouleversaient l’ordre social et ébranlaient le droit et la coutume d’antan, en employant parfois la violence, souvent les pressions et l’intimidation.
Ils volaient littéralement leur part de communaux aux pauvres, et abattaient les maisons que ceux-ci, grâce à la force jusque-là inébranlable de la coutume, avaient longtemps considérées comme leur appartenant, à eux et à leurs héritiers.
Le tissu de la société se déchirait; les villages abandonnés et les demeures en ruine témoignaient de la violence avec laquelle la révolution faisait rage, mettait en danger les défenses du pays, dévastait ses villes, décimait sa population, changeait en poussière son sol épuisé, harcelait ses habitants et les transformait, d’honnêtes laboureurs qu’ils étaient, en une tourbe de mendiants et de voleurs.2
L’analogie entre le premier et le deuxième mouvement des enclosures est donc extrêmement forte et suggestive. À sa lumière, les réformes récentes de la propriété intellectuelle apparaissent comme de véritables calamités sociales.
L’effet immédiat recherché par les tenants de l’analogie est donc de susciter une indignation comparable à celle exprimée par les auteurs classiques que nous avons mentionnés.
Plus profondément, le parallèle tracé entre les deux mouvements d’enclosures construit un objet conceptuel, qui permet de regrouper ces deux tendances historiques : les biens communs (commons).
Dans les deux cas, nous aurions ainsi affaire à un « processus d’expropriation portant sur des biens communs »1, autrement dit à la conversion de ressources auparavant soustraites à la logique du marché en possessions privées permettant à une minorité de s’enrichir au détriment de l’intérêt du plus grand nombre.
1 Thomas MORE, L’utopie, op. cit., p. 100-101.
2 Karl POLANYI, La grande transformation : aux origines politiques et économiques de notre temps, traduit de l’anglais par Catherine Malamoud et Maurice Angeno, Paris, Gallimard, 1983, p. 61.
La notion de « biens communs » permet d’attaquer une conviction bien implantée dans nombre d’esprits : celle selon laquelle la propriété privée serait le seul moyen d’assurer une allocation et une gestion efficaces des ressources, qu’il s’agisse de terres agricoles ou des « immatériels de l’esprit ».
Cette conviction est souvent associée à un article du biologiste Garrett Hardin : « The Tragedy of the Commons »2. L’auteur y considère la situation « idéale-typique » d’un champ, dans lequel tous les éleveurs ont le droit de faire paître leurs troupeaux. Chacun, dit-il, sera tenté d’ajouter des bêtes à son cheptel pour profiter au maximum de la ressource commune. Mais ce faisant, tous finiront par entraîner l’épuisement du champ, et partant la ruine de tous.
Le texte de Garrett Hardin se présente ainsi comme une justification théorique, dans le cadre conceptuel de la théorie des jeux3, de la nécessité des enclosures.
Il en est surtout venu à être considéré comme la démonstration que l’appropriation privée constituait le meilleur système d’allocation et de gestion des ressources, dans la mesure où il serait seul à même de garantir un intérêt suffisant pour l’entretien de celles-ci.
Le raisonnement de Garrett Hardin était censé s’appliquer uniquement aux ressources physiques existant en quantité limitée. Il en est pourtant venu à discréditer toute forme de gestion collective, et à légitimer la mise en œuvre systématique de logiques de marché.
Il se présente ainsi comme un des fondements conceptuels de l’idée selon laquelle les incitations marchandes seraient le meilleur moyen d’encadrer l’activité humaine. Nombre de discours défendant les extensions contemporaines de la propriété intellectuelle reprennent du reste la structure de l’argumentation d’Hardin, à ceci près qu’ils insistent sur la « production » des ressources plus que sur leur « entretien ».
Il sera par exemple affirmé que la brevetabilité des gènes humains est le meilleur moyen de stimuler la recherche, ou encore que la défense scrupuleuse de la propriété intellectuelle sur Internet est le seul moyen de pousser les artistes à créer4.
1 Philippe AIGRAIN, Cause Commune, op. cit., p. 139.
2 Garrett HARDIN, « The Tragedy of the Commons », Science, n°162, 1968, p. 1243-1248.
3 La « tragédie des biens communs » est ainsi souvent rapprochée du dilemme du prisonnier. La démonstration de Garett Hardin a du reste été formalisée comme une variante de celui-ci par plusieurs auteurs. Cf. Robyn M. DAWES, « The Commons Dilemma Game : An N-Person Mixed-Motive Game with a Dominating Strategy for Defection », ORI Research Bulletin, n°13, 1973, p. 1-12.
4 Une illustration caricaturale de cet argument fut fournie par la campagne de publicité lancée en juin 2011 par l’Hadopi. Son principe consistait à soutenir que sans la loi de lutte contre le « piratage », les artistes de demain ne seraient pas apparus. « Sans Hadopi, pas d’Emma Leprince, future auteure de «Je préfère ton clone», révélation musicale de l’année 2022 », affirmait par exemple une affiche.
Comme le remarque James Boyle, l’expression « tragédie des biens communs » a donc exercé une influence considérable sur les représentations collectives, influence qui s’étend bien au-delà du domaine de validité propre au modèle de Garrett Hardin :
« La tragédie des biens communs ». Cette phrase, encore plus que les arguments développés dans l’article du même nom, en est venue à exercer un pouvoir considérable sur les politiques actuelles. […] Dire d’une ressource sociale qu’elle n’est pas possédée par un individu, qu’elle est aussi libre d’être utilisée que l’air que nous respirons, c’est automatiquement évoquer l’idée qu’elle est gaspillée.1
Dans le monde scientifique et universitaire, ces représentations ont toutefois été battues en brèche par les travaux de plusieurs chercheurs, les plus célèbres étant ceux du prix Nobel d’économie Elinor Ostrom.
Son ouvrage classique publié en 1990, Governing the Commons, s’inscrit explicitement dans le cadre d’une critique du modèle de Garrett Hardin et de l’utilisation politique qui en a été faite.
À travers de nombreuses études de cas2, Elinor Ostrom fait valoir qu’il existe d’autres mécanismes que l’appropriation privée (ou la régulation par une autorité centrale) pour éviter la « tragédie des biens communs ».
Elle montre qu’il est possible à des individus de s’auto-organiser et de s’autogouverner pour gérer des ressources communes, « dans des situations où les tentations de resquiller et de ne pas respecter ses engagements sont légion »3.
Autrement dit, les analyses d’Elinor Ostrom réhabilitent la notion de « biens communs », en la liant étroitement à des communautés bien délimitées, et à des règles sociales négociées permettant de gérer adéquatement les ressources communes4.
Peu à peu, les défenseurs des biens communs « immatériels » se sont aperçus que si le modèle de Garrett Hardin avait été (de manière assez abusive) appliqué aux domaines couverts par les droits de propriété intellectuelle, le modèle concurrent d’Elinor Ostrom pouvait lui aussi être étendu à des ressources autres que les pêcheries, les forêts ou les pâturages étudiés par la chercheuse américaine.
Les collectifs du logiciel libre en sont ainsi venus à être considérés comme étant très semblables aux organisations analysées par Elinor Ostrom1. Ils ont été abordés comme des communautés, au sein desquelles le travail s’effectue selon des normes partagées2.
Certains en sont même venus à dire que « le mouvement des logiciels libres met en avant la notion de «biens communs» : créés par des communautés, protégés par ces communautés […] et favorisant l’élargissement des communautés bénéficiaires »3.
Elinor Ostrom a elle-même cherché à étendre et à adapter ses analyses aux « biens communs de la connaissance » (notamment aux logiciels libres), en considérant ceux-ci comme des ressources partagées, donnant lieu à des procédures d’autogouvernement au sein des groupes qui les gèrent4.
1 James BOYLE, The Public Domain, op. cit., p. 47.
2 Les exemples traités par Elinor Ostrom concernent des « ressources communes de petite échelle, situées dans un seul pays et dont le nombre d’individus impliqués varie entre 50 et 15 000 personnes, qui sont fortement dépendantes de la ressource commune sur le plan économique. Ces ressources communes se composent principalement de pêches littorales, de petites zones de pâturage, de nappes phréatiques, de systèmes d’irrigation et de forêts communales » (Elinor OSTROM, Gouvernance des biens communs, op. cit., p. 40).
3 Ibid., p. 41.
4 Cf. Fabrice FLIPO, « Elinor Ostrom, le retour en grâce des institutions », 13 novembre 2010, en ligne : http://www.mouvements.info/Elinor-Ostrom-le-retour-en-grace.html (consulté le 08/11/2011).
Ce rapprochement entre biens communs « matériels » et « immatériels » semble justifié dans certains cas. L’organisation d’un projet comme Debian témoigne en effet de formes d’autogouvernement élaborées, qui reposent sur des normes partagées et sur des règles formelles établies par les participants pour encadrer la production de la ressource commune (cf. chapitre 4).
Dominique Cardon et Julien Levrel ont quant à eux avancé que « la gouvernance de Wikipédia constitue une illustration presque parfaite » du modèle d’Elinor Ostrom, quand bien même « celui-ci a été initialement établi pour la gestion d’une ressource matérielle »5.
Il existe néanmoins des différences évidentes entre biens communs intellectuels et physiques, que les auteurs du récit des biens communs ne manquent pas de relever. James Boyle cite ainsi le caractère « non rival » des premiers, qui les distingue de ressources épuisables comme la terre, et change la nature des problèmes auxquelles les communautés doivent faire face.
Dans un cas, il s’agit de trouver des mécanismes permettant de favoriser la production des ressources en jeu; dans l’autre, la question est avant tout celle de la préservation de celles-ci.
Les problématiques sont donc d’une certaine manière inverses : « si un pâturage peut éventuellement être menacé de surexploitation, c’est au contraire la sous-exploitation qui guette les biens publics immatériels »1.
1 James Boyle écrit par exemple qu’ils s’intègrent (fit) très bien « au sein des analyses récentes sur la gouvernance des biens communs proposées par Elinor Ostrom, Robert Keohane, Margaret McKean et bien d’autres » (James BOYLE, « The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain », op. cit.)
2 Cf. Amy KAPCZYNSKI, « Access to Knowledge : A Conceptual Genealogy », op. cit.
3 Hervé LE CROSNIER, « Leçons d’émancipation : l’exemple du mouvement des logiciels libres » in COLLECTIF, Les biens communs de la connaissance, op. cit., p. 175-192. La formulation nous semble un peu fautive, dans la mesure où Richard Stallman et le mouvement du free software emploient rarement eux mêmes le vocabulaire des biens communs, bien que ce soit sans doute un peu plus le cas désormais.
4 Cf. Elinor OSTROM et Charlotte HESS (ed.), Understanding Knowledge as a Commons. From Theory to Practice, op. cit.. Notons que dans cet ouvrage les auteurs utilisent comme ils le reconnaissent eux-mêmes « les termes biens communs de la connaissance et biens communs de l’information de façon interchangeable » (p. 9).
5 Dominique CARDON et Julien LEVREL, « La vigilance participative. Une interprétation de la gouvernance de Wikipédia », op. cit. Il nous semble néanmoins que la dimension communautaire n’est pas tout à fait assez présente au sein de Wikipédia pour que ce projet puisse être considéré comme tout à fait semblable au modèle d’Ostrom.
Elinor Ostrom et Charlotte Hess ont elles remarqué que « par contraste avec la situation qui vaut dans le cas d’une pêcherie ou d’une nappe phréatique, il est plus difficile de saisir et de délimiter la communauté qui contribue, utilise et gère un bien commun de la connaissance »2. L’exemple des logiciels libres rend par exemple particulièrement sensible le fait que les producteurs et les utilisateurs ne sont pas toujours les mêmes personnes; le deuxième groupe étant en général beaucoup plus large que le premier.
Il existe alors non pas une mais deux « communautés » : celle des producteurs et celle des utilisateurs. Or la première semble être la seule à pouvoir rentrer – moyennant l’occultation de certaines différences plus marginales – dans le cadre du modèle proposé par Elinor Ostrom pour les biens communs physiques.
Dans la mesure où il embrasse les analyses de celle-ci, le récit des biens communs s’applique donc davantage aux communautés de créateurs de logiciels libres qu’au groupe plus étendu de leurs utilisateurs.
Il conduit à aborder les « libristes » comme des commoners, soudés par un ethos commun, et construisant des collectifs fonctionnant sur la base de règles collectivement négociées.