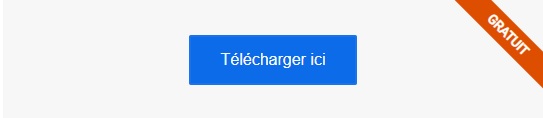II. DES EMEUTES INSCRITES DANS L’HISTOIRE DES VIOLENCES EMEUTIERES
Si les émeutes de 2005 ont surpris par leur ampleur et si les observateurs s’accordent sur leur caractère inédit – nous venons de le voir – il n’en reste pas moins que ce ne sont pas les premières que connaît la France, et qu’au regard de leurs aspects les plus généraux, elles s’inscrivent dans l’histoire d’un quart de siècle d’affrontements et de violences en banlieue, mais aussi dans une histoire plus longue du phénomène émeutier. En effet, selon Didier Lapeyronnie, malgré leurs spécificités, ces émeutes « ne présentent sûrement pas une “rupture” de cette histoire, bien plutôt la consolidation de logiques et de situations déjà lourdement présentes dans les quartiers populaires »220. C’est pour cela que nous avons choisi de revenir sur cette histoire du phénomène et sur l’émergence de sa médiatisation.
A. Des émeutes urbaines en France depuis les années 1970…
Les émeutes urbaines que connaît la France en 2005 ne sont donc pas une nouveauté. Depuis le début des années 1970, le pays connaît des cas d’émeutes dans les quartiers populaires et les banlieues de ses grandes métropoles. Si beaucoup d’auteurs considèrent que les premières émeutes urbaines françaises ont lieu en 1979 à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, Michelle Zancarini-Fournel221, historienne, identifie déjà des incidents violents en 1971, à la cité de la Grapinière, à Vaulx-en-Velin. Essayant de retracer la généalogie des « rebellions urbaines »222, elle retrouve, évoqués dans les archives de l’administration préfectorale de l’époque, des « rodéos », des « escarmouches », des « effervescences », et des « incidents »223. Les prémisses des émeutes urbaines telles qu’on les connaît aujourd’hui sont alors posées.
En 1979, Vaulx-en-Velin connaît d’autres émeutes. Des affrontements entre les forces de l’ordre et des groupes de jeunes s’accompagnent de voitures brûlées. En 1981, la cité des Minguettes à Vénissieux, toujours dans la banlieue lyonnaise, va connaître un “été chaud”. Des jeunes se livrent à des courses de voitures volées avant de les incendier et ces “rodéos”, comme ils vont être appelés, vont provoquer l’intervention des forces de l’ordre. La situation dégénère rapidement en véritables émeutes. Ces événements vont être les premiers à connaître une couverture médiatique de grande ampleur et seront à l’origine de la Marche pour l’égalité et contre le racisme, en 1983.
Dans les années 1990, d’autres émeutes vont avoir lieu. En octobre 1990, éclate une série d’émeutes à Vaulx-en-Velin, à la suite de la mort d’un jeune motard, lors d’une course- poursuite avec la police. Dans les heures qui suivent la mort de Thomas Claudio, 16 ans, le quartier du Mas du Taureau “s’enflamme”. Pendant plusieurs nuits consécutives, des affrontements ont lieu avec la police, des incendies sont déclenchés et le centre commercial sera pillé. Dans les mois qui suivent, « d’autres émeutes plus ou moins importantes vont avoir lieu »224 : à Argenteuil où des magasins sont pillés, à Montfermeil, à Grenoble ou encore à Sartrouville, à la suite de l’assassinat d’un jeune homme par un vigile, à l’entrée d’une cafétéria. Les 25 et 26 mai 1991, des incidents éclatent dans le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie, après la mort d’un jeune du quartier pendant une garde-à-vue.
Par la suite des émeutes prennent forme dans le XVIIIe arrondissement de Paris en 1993, à la cité des Fontenelles à Nanterre en 1995 ou encore dans le quartier Saint-Jean à Chateauroux en 1996. Une nouvelle vague d’affrontements a lieu à la fin de l’année 1997. Dans la nuit, du 2 au 3 novembre notamment, de violentes émeutes éclatent dans le quartier de La Duchère à Lyon où quatre personnes trouvent la mort. A Dammaris-les-Lys, le conducteur d’une voiture qui avait forcé un barrage de police est abattu par la police d’une balle dans la tête. S’ensuivra près d’une semaine d’émeutes. Et à Strasbourg, dans les quartiers du Neuhof et de Hautepierre, de nombreuses voitures sont incendiées, « avec un point culminant le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre où 53 voitures sont brulées »225. En 1998, c’est le quartier du Mirail à Toulouse qui “s’embrase” et l’on observe de violents affrontements entre émeutiers et forces de police. Le point de départ : la mort d’Habib Ould Mohamed des suites d’une bavure policière lors d’un flagrant délit de vol de voiture.
Pendant les années 2000, la série se poursuit avec notamment des émeutes dans les quartiers de la Grande Borne à Grigny et des Tarterêts à Corbeil Essonne, à Lille, à Montbéliard, en 2000, à Vitry-sur-Seine et dans le quartier de Borny à Metz, en 2001, dans le quartier des Hautepierre à Strasbourg et aux Mureaux dans les Yvelines, en 2002 ou encore à Nîmes et à Avignon en 2003.
Après les émeutes de 2005, la France connaît de nouveau des épisodes de violence. Fin mai 2006, de violents affrontements opposent jeunes et forces de l’ordre à Montfermeil, en Seine- Saint-Denis. Et en novembre 2007, c’est à Villiers-le-Bel, dans le Val-d’Oise, que de violents incidents éclatent à la suite du décès de deux adolescents du quartier, âgés de 15 et 16 ans, après avoir percuté une voiture de police en moto dans des circonstances qui, aujourd’hui encore, restent floues.
Même si nous avons choisi d’axer notre chronologie des émeutes sur les émeutes françaises, il n’en reste pas moins que les émeutes de 2005 s’inscrivent également dans une histoire internationale des émeutes urbaines. En effet, le phénomène émeutier dans les quartiers sensibles n’est pas uniquement visible en France. On observe des séries d’émeutes aux États- Unis et en Grande-Bretagne226 notamment.
Pour ce qui est des États-Unis tout d’abord, les premières émeutes éclatent dès 1965, dans le quartier de Watts à Los Angeles. Comme c’est quasiment toujours le cas – nous l’avons vu pour les émeutes françaises –, elles font suite à des incidents avec la police et donneront lieu à des affrontements avec la police. Les années suivantes, en 1966, 1967 et 1968, le pays connaîtra d’autres émeutes, à Chicago, Cleveland, Tempa, Cincinnati, Atlanta, Newark ou encore Détroit. En 1966, on recense près de 43 émeutes et plus de 164 en 1967, « dont 8 suffisamment sérieuses pour nécessiter l’intervention de l’armée. »227. Les émeutes qui éclatent à Detroit en 1967, à la suite d’une descente de police dans un débit de boisson clandestin qui a dégénéré, feront 38 morts. En 1992, comme nous l’avons vu en introduction, Los Angeles connaîtra une autre série d’émeutes particulièrement violentes. On comptera près de 58 morts, 2400 blessés, 4500 commerces détruits et un milliard de dollars de dégâts. Ces émeutes éclatent à la suite de l’acquittement de quatre policiers “blancs” qui avait passé à tabac, Rodney King, un automobiliste noir.
225 Lapeyronnie Didier, « Les émeutes urbaines, en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis », op. cit., p. 8.
226 Il ne s’agit pas pour nous de faire une revue détaillée de tous les cas d’émeutes qu’ont connu ces deux pays. Nous ne présenterons que quelques séries d’émeutes qui ont marqué l’histoire des émeutes urbaines.
En ce qui concerne la Grande-Bretagne, la plupart des “grandes émeutes” que connaît le pays éclatent dans les années 1980-1990. Dans les années 1980 des vagues d’émeutes éclatent dans les quartiers centraux de grandes villes. C’est le cas à Bristol en 1980, à Londres (dans les quartiers de Brixton et Southall), à Liverpool (dans le quartier de Toxteth) et à Manchester (quartier de Moss Side) en 1981, « et à nouveau dans les villes princip
ales en 1985, y compris Birmingham (Handsworth). »228. A Bristol, en 1980, la ville est le théâtre d’affrontements entre quelques 200 jeunes Noirs et policiers. Ceux-ci seront déclenchés à la suite d’une interpellation policière à propos d’une infraction au Code de la Route.
Dans les années 1990, le pays connaît également des émeutes, notamment à Oxford dans la cité de Blackbirds Legs en 1991, à Bristol en 1992 et à Brixton en 1995. Celles de Bristol, en 1992, font suite au décès de deux jeunes qui avaient volé une voiture, dans une course- poursuite avec la police. Les jeunes du quartier mettent le feu à la bibliothèque de la ville, au centre communautaire et pillent les magasins. A Brixton, trois ans plus tard, le scénario est encore similaire : la mort d’un jeune homme lors d’un interrogatoire dans les locaux de la police suscite l’émotion. Une manifestation est organisée. Elle dégénère en émeute.
Plus récemment, en 2005, la ville de Birmingham sera de nouveau le théâtre d’émeutes. Parties de la rumeur du viol d’une jeune jamaïcaine de 14 ans par une vingtaine d’hommes d’origine sud-asiatique dans le quartier de Lozells, des émeutes éclatent pendant deux jours, faisant de nombreux blessés et même un mort.
Même si ces émeutes anglo-saxonnes et américaines ne sont pas en tout point similaires avec celles que l’on peut connaître en France car prenant généralement la forme d’affrontements entre communautés ethniques – chose que l’on n’observe pas dans les émeutes françaises – ou encore parce qu’elles sont beaucoup plus violentes – jamais les émeutes françaises n’ont fait autant de morts – on constate tout de même quelques similitudes. En effet, en observant les cas étrangers mais aussi les cas français, il se dégage des similitudes, notamment en ce qui concerne le scénario de déclenchement, les relations avec la police ou encore les quartiers dans lesquels ces émeutes se produisent.
B. … Mais un phénomène é meutier visible depuis des siècles…
Nous venons de le voir, les émeutes de 2005 sont le continuum d’une série d’émeutes urbaines qui apparaissent au début des années 1970 et qui éclatent régulièrement et en des lieux divers, au cours des décennies suivantes. Mêmes inédites, les émeutes de novembre 2005 s’inscrivent donc dans un peu plus d’un quart de siècle de violences en banlieue, de « rodéos » et d’affrontements entre jeunes de quartiers “sensibles” et forces de l’ordre. Mais elles s’inscrivent également dans une histoire plus longue du phénomène émeutier, dans ce que Jean Nicolas appelle aussi le « phénomène rébellionnaire »229. Parce que si les émeutes urbaines “modernes”, c’est-à-dire telles qu’on les conçoit aujourd’hui (émeutes qui éclatent dans les quartiers populaires des grandes métropoles, entre jeunes et forces de l’ordre, où les jeunes brûlent des voitures, dégradent des bâtiments etc.), apparaissent bien dans les années 1970, le phénomène émeutier, dans son acception plus large, c’est-à-dire ce que l’on pourrait appeler des actions populaires en groupe, accompagnées de violence, est visible depuis de nombreux siècles. Émeutes de subsistance, émeutes contre l’appareil policier, judiciaire ou militaire, émeutes contre l’Église pour la dîme… la liste est longue. Et de ces émeutes, de ces « tumultes »230 rébellionnaires, on en trouve trace notamment sous l’Ancien Régime. En effet, comme nous le rappelle Jean Nicolas dans La rébellion française231, si de 1661 à 1789 – période qu’il étudie – la France n’a connu aucune révolution, la société française a tout de même « vécu sur le mode de l’intranquillité, selon des rythmes inégaux, mais dans un frémissement quasi ininterrompu. »232
Aussi, l’auteur identifie près de 8500 émotions233 sur la période, « de toute nature et de tout calibre »234. Si le tiers de ces émotions ne sont que des « tumultes d’importance réduite »235, elles peuvent s’avérer dans un peu moins de la moitié des cas être des « rebellions plus graves »236, qui mobilisent entre 11 et 50 personnes et dans un quart des cas des « révoltes et séditions avérées auxquelles ont participé plus de 50 individus »237. Et ces agitations, que l’on identifie sur l’ensemble du territoire français, dans tous les départements et toutes les régions, ne sont pas également réparties entre ville et campagne. En effet, ces émotions concernent avant tout les agglomérations. Ainsi « avec 40,4% des cas enregistrés, les villes – qui ne regroupent que 15% de la population française – constituent la matrice rébelliogène par excellence. »238. Dans les campagnes et les villages, si le nombre d’émeutes est quasiment identique à celui enregistré par les villes (40,2%), il n’en reste pas moins que les agitations sont de moindre importance en terme d’intensité et de nombre de participants. En ce qui concerne les bourgs239, ils semblent être beaucoup plus calmes et ne comptabilisent qu’un cinquième des cas enregistrés.
Les participants de ces mouvements collectifs de protestations, quelque en soit leur nombre, proviennent essentiellement des classes populaires. En effet, « c’est le bas de la société qui se jette dans la rue, réclame du pain, attaque les postes de police, malmène les huissiers de justice, brutalise les collecteurs d’impôts et les agents du seigneur ou défend au corps à corps la statue du saint protecteur brutalement déclassé par un curé moderniste… »240.
Quant à leurs cibles, aux « différents déclencheurs de rébellion »241 – nous venons d’en apercevoir quelques-unes –, elles sont nombreuses et diverses. Au premier rang de ces déclencheurs et loin devant les autres cibles émeutières : la colère contre le fisc et plus particulièrement contre les impôts indirects. Cela n’a rien d’étonnant car si « la rébellion s’en était toujours pris à l’impôt »242, la part très importante de cette cible dans les rebellions de l’Ancien Régime peut s’expliquer par le fait que la fiscalité se soit nettement alourdie lors du XVIIe et du XVIIIe siècle. Viennent ensuite, au second rang, les difficultés alimentaires. Se développent alors des émeutes de marchés et les plus modestes se mettent à attaquer les greniers et les convois de grains. Les formes d’« opposition collective à l’appareil répressif de l’État »243, prennent la troisième place. Des rebellions contre la police ou la maréchaussée éclatent alors, notamment à la suite d’arrestations – nous y reviendrons. Viennent ensuite, des émotions diverses, qui sont le plus souvent des actes de défoulement collectif sans objet de contestation véritable, les « affaires antiseigneuriales »244 ou encore « les conflits salariaux et autres affrontements au sein du monde du travail »245. Dans le bas de l’échelle de ces déclencheurs d’émeutes se trouvent aussi les rebellions liées aux croyances et aux faits religieux, la remise en cause des autorités municipales ou encore « la rébellion à couleur régionaliste »246. Des cas de violences à l’encontre de particuliers, de notables, de gens d’Église ou encore de membres de la noblesse sont également répertoriés.
Et si une bonne partie de ces révoltes ont « pour moteur des atteintes matérielles objectives »247 comme l’impôt sous toutes ses formes, la nourriture, le salaire ou encore l’organisation seigneuriale et ont donc un « schéma revendicatif clair […], axé sur l’argent ou le statut, sur la défense par le groupe d’intérêts familiaux ou individuels »248, d’autres émeutes « ont leurs racines non dans l’intérêt immédiat, mais la sphère des affects »249. Ainsi, nombre d’affaires font suite à des situations où sentiment d’injustice et émotion s’entremêlent.
« Il s’agit d’impressions provoquées par des scènes fortes, de sentiments moraux violés par l’imposition brutale d
e l’ordre, de frustrations individuelles débouchant sur une colère libératrice, parfois même de fantasmes gros de paniques vengeresses. »250 Ce type de révolte que l’on pourrait qualifier d’“émeutes de l’affect”, se retrouve dans les actes de résistances collectives dirigées contre les forces de police, quand celles-ci tentent d’arrêter des individus. En effet, lors d’arrestations jugées injustes, il arrive que la foule, témoin de la scène, se rassemble et s’en prenne aux forces de l’ordre. Si ces émeutes sont généralement limitées à des groupes restreints de 20 à 50 personnes, il arrive parfois qu’elles rassemblent des centaines voire des milliers de personnes « des deux sexes et de tout âge »251. Et le scénario est souvent identique : un miséreux, généralement mendiant est arrêté par les forces de police.
Il résiste, refusant d’avancer et s’agrippant à tout ce qu’il peut pour freiner sa progression. La foule interpellée et curieuse se masse autour de la scène et « s’identifie au pauvre malmené »252. La police apparaît alors « comme l’instrument d’une insupportable tyrannie »253. Les insultes fusent et rapidement, les coups pleuvent. Ainsi « après les cris, [ce sont] les coups de poing ou de manches d’outils, les bûches, les projectiles divers selon ce qui se trouve à portée. »254. Et si ces affrontements avec la police concernent des gens de tout âge – nous l’avons vu – les jeunes ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit d’actes rébellionnaires. Sur la période qu’examine Jean Nicolas, les actes qui relèvent de la contestation de la jeunesse représentent à peu près 7% des cas d’émeutes, soit plus de 634 affaires.
Et l’origine des désordres provoqués par les jeunes sont divers. Ils vont des « plus innocents »255, comme l’agitation nocturne qui ne relève que de la simple turbulence, aux plus subversifs, comme les heurts avec les forces de l’ordre ou la maréchaussée ou les conflits avec les autorités locales, en passant par les « plus ritualisés »256, comme les bagarres entre bandes voisines. Outre ces bagarres et autres affrontements entre bandes, lors des fêtes locales principalement, « il y a de la part des jeunes, une fronde bien ciblée contre tout ce qui représente l’autorité en uniforme ou en chaperon municipal, contre les soutanes et les galons dorés. Rejet de la coercition morale, celle qui empêche de vivre à sa guise ou de s’amuser, refus au degré primaire de ce qui représente sur place la contrainte des institutions, de l’État, de l’Église, de la seigneurie si présente et pesante encore. »257
Ainsi, l’étude des rebellions et des cas d’émeutes de l’Ancien Régime permet de dégager des éléments que l’on retrouve dans les émeutes contemporaines. Ces “émotions”, comme elles sont appelées, sont majoritairement urbaines et sont le fait d’individus appartenant aux classes populaires, comme c’est le cas des émeutes contemporaines. Même si les causes de ces émeutes peuvent être diverses, certaines peuvent être provoquées par une intervention policière jugée illégitime et injuste et c’est invariablement le cas des émeutes contemporaines. Et par ailleurs, les jeunes ne sont pas forcément étrangers à ces rébellions et s’inscrivent, pour une partie d’entre eux, dans le rejet de l’autorité, des institutions et de l’État, comme c’est généralement le cas des émeutes contemporaines.
C. … que l’on médiatise fortement dès le XIX e siècle.
Si les émeutes de 2005 sont à inscrire dans une histoire plus longue du phénomène émeutier et rébellionnaire – ce que nous venons de faire – il paraît également intéressant de remonter aux sources de la médiatisation de ce type d’épisodes de violence. En analysant quelles logiques étaient à l’œuvre dans le traitement médiatique de la violence lorsqu’il est apparu, cela nous permettra peut-être de mieux comprendre les logiques actuelles et de les mettre en perspectives.
Pour mener à bien cette analyse, nous nous appuierons sur les travaux de Dominique Kalifa, historien spécialiste de l’histoire du crime et de ses représentations et plus particulièrement, sur une de ses contributions : « Les journaux et la “sécurité publique” au XIXe siècle »258 car même s’il n’étudie pas directement le traitement médiatique des émeutes, il analyse l’émergence au XIXe siècle du traitement des violences et de l’insécurité dans les journaux français. Et selon lui, le XIXe siècle marque un tournant dans le traitement médiatique des violences et de la question sécuritaire. En effet, comme le rappelle l’auteur, « la question de l’insécurité n’est pas née au tournant des années 1990, ni au début des années 1970 lorsque la France “avait peur”, ni même avec l’invention des blousons noirs dans la décennie 1950 »259 mais au XIXe siècle. Et cela parce que cette époque marque une convergence de paramètres favorables à l’émergence de la question et du discours sécuritaire.
D. Kalifa distingue trois constituants nécessaires à l’émergence de ce discours : des statistiques judiciaires ou policières qui soient publiques et disponibles ; une représentation parlementaire « fonctionnant comme une tribune politique légale et l’instrument d’un débat public légitime »260 ; et enfin un appareil médiatique « capable de donner une large visibilité sociale aux réalités délinquantes »261. Et pour l’auteur, cette convergence, toujours opérante à l’heure actuelle, naît au XIXe siècle. En effet, c’est à cette époque que sont publiées les premières statistiques judiciaires « homogènes et continues du pays »262. Aussi, le Compte général de l’administration de la justice criminelle publie son premier volume en 1827 et les données statistiques deviennent « le principal indicateur et matériau du discours sécuritaire »263. C’est également à cette période, en 1825, que naît la Gazette des Tribunaux, un quotidien entièrement dédié aux questions de justice et de crime. Et concernant le troisième élément convergent, la représentation parlementaire, même fébrile et réduite, est bien présente dans ces années 1820-1830, période de la Restauration.
C’est donc à cette époque, à la fin de la Restauration, dans les années 1826-1927, qu’ « est repérable l’expression d’une problématique moderne de l’insécurité, fondée sur l’émergence d’un débat public virulent concernant les risques d’agressions nocturnes à Paris et dans les grandes villes. »264 Ainsi, les fait-divers envahissent les pages des journaux de l’époque et le thème de l’insécurité est largement exploité. Et cela dès 1826, moment où les principaux journaux du pays publient une longue série d’articles « alarmistes »265 sur la recrudescence des attaques nocturnes à Paris. L’écriture fait-diversière prend forme et une sorte de « trame narrative »266 s’établit, en décrivant avec la plus grande précision possible « les modalités de l’agression (l’embuscade nocturne, l’étranglement), le profil des agresseurs (le rebut des “classes inférieures”), les quartiers dangereux, l’insuffisance de la police »267, tout cela se terminant sur « l’expression d’une profonde exacerbation publique.»268. Face à cette “emballement” médiatique, les autorités publiques s’en prennent aux journaux qu’elles accusent de semer le trouble et d’insuffler un vent de panique. Ainsi, « la donne médiatique, affectant un lectorat qui est aussi un électorat s’impose dès lors comme un élément majeur de ce débat »269.
Si l’engouement visible en 1926 s’estompe assez vite, des épisodes similaires d’ « “émotions” sécuritaires »270 réapparaissent pendant la monarchie de Juillet, en 1836, 1839 et 1844-1846 notamment. Lors de cette période, si les « poussées de fièvre »271 sont analogues, elles sont accentuées par un climat social de pe
ur aiguë qui pousse à la production toujours croissante de statistiques et d’enquêtes sociales, et par l’augmentation de la diffusion des journaux français. Ainsi, lors des années 1843-1844, que l’auteur analyse comme « un nouveau paroxysme »272, les récits d’attaques nocturnes, les observations critiques sur la sécurité dans les grandes villes et autres faits-divers inondent les journaux. Et c’est en ces termes que le Journal des débats parle, à l’époque, de ce genre de faits : « Les escarpes, vous le savez, ce sont les voleurs de nuit, embusqués dans les rues désertes, l’œil fait à l’obscurité, l’oreille ouverte au moindre bruit, épiant de loin l’arrivée d’un passant sur lequel ils tombent à l’improviste, qu’ils frappent pour l’étourdir, qu’ils étranglent ou qu’ils poignardent pour étouffer ses cris, et qui, après ces horribles luttes s’en vont ramasser dans la boue ou dans le sang les quelques pièces d’argent abandonnées par leurs victimes. »273. Autant dire que les journaux donnent dans le sensationnalisme et participent à cette peur sociale.
Ces faits-divers alarmistes disparaissent complètement des pages des journaux au moment du Second Empire, en raison de la censure qui s’installe et de « la rétractation du débat public »274, mais réapparaissent lorsque la liberté de la presse est retrouvée à la fin de l’Empire. La France connaît alors un véritable regain d’inquiétude sécuritaire d’autant plus importante que se constitue une presse de masse et qu’apparaît une démocratie parlementaire. L’insécurité grandissante dans les grandes villes est alors de nouveau pointée par les journaux, de véritables « campagnes alarmistes affectent alors le pays »275 et la question sécuritaire s’enracine progressivement dans le discours médiatique. Lors d’une première phase, qui ne concerne que Paris, lors des années 1881-1885, le discours se généralise et se radicalise avec l’apparition d’une presse « particulièrement hostile à l’institution policière »276. La campagne médiatique portée par l’ensemble des journaux trouve même des échos au niveau politique au niveau municipal mais aussi au niveau gouvernemental. En effet, « le mouvement fut […] porteur, et les propos inquiets se multiplièrent à mesure que la préfecture de police, puis le gouvernement Waldeck Rousseau s’appropriaient le thème sécuritaire, même si c’était pour le désamorcer par la mise en œuvre de politiques plus répressives (rafles dans les quartiers “dangereux”, vote de la loi sur la relégation des multirécidivistes). »277
Lors de la deuxième phase, que D. Kalifa identifie dans les années 1900-1914, phase « plus virulente »278, le thème de l’insécurité et la médiatisation devient à la mode et entre « dans l’âge adulte »279. Ainsi l’argumentaire développé à cette époque, est peu à peu repris par des acteurs politiques qui en font un thème porteur pour leurs campagnes politiques jusqu’à ce qu’en 1914, « la question de la sécurité publique [devienne] un fait médiatique et politique important, autour duquel [commencent] sérieusement à s’ordonner programmes, campagnes et stratégies. »280
Conclusion
Au travers de l’étude des émeutes de l’automne 2005 dans un premier temps, puis de l’histoire des violences émeutières dans les banlieues françaises et étrangères, dans un second temps, nous avons pu dégager les logiques inhérentes au phénomène émeutier et leurs aspects récurrents comme leur déclenchement, les quartiers concernés, les relations avec la police, les répertoires d’actions, etc.
Le retour sur les émeutes de 2005 plus particulièrement, a également permis de saisir, dans le détail, les logiques spécifiques de ces émeutes. Cela nous a permis de comprendre ce qui s’était concrètement produit sur le terrain des violences et sur le terrain politique, de comprendre d’où partaient ces émeutes, leurs trajectoires et leurs évolutions, de comprendre qui étaient les émeutiers et quelles avaient été les raisons de leur colère, de comprendre aussi quelles réponses politiques avaient été données aux violences et à la crise plus profonde que connaissent les banlieues et d’entrevoir les différentes réactions de la classe politique.
Cela nous permettra, lors de notre analyse du traitement médiatique de ces émeutes, de comprendre et de mettre en perspective les propos et les angles d’approches des journaux étudiés, de voir quels éléments constitutifs des événements ont été traités ou encore quelles réactions ou versions politiques ont été relayées ou critiquées. En effet, une bonne connaissance des événements et de leurs antécédents nous paraît nécessaire pour saisir au mieux, le discours journalistique et les différentes logiques du système médiatique. En ce sens, l’analyse de l’émergence et de l’évolution de la question sécuritaire tout au long du XIXe siècle, même si elle n’apporte pas d’éléments sur le traitement des émeutes en particulier, permet de mettre au jour les différents éléments fondateurs du discours journalistique sur les violences “urbaines” et son évolution. Ces éléments permettront probablement de mieux appréhender certaines facettes du discours journalistique sur les émeutes de 2005.
Lire le mémoire complet ==> Les émeutes de l’automne 2005 dans les médias : étude comparée du traitement de cinq quotidiens français
Mémoire de recherche de Master 2 de Science politique
Institut d’Etudes Politiques de Lyon