Les contrats de consortium ou de cotraitance – Chapitre 2 : « Une simple lecture de la presse technique internationale suffit à confirmer l’existence dans le monde entier, d’une multiplicité d’entités hétéroclites et de groupements divers généralement qualifiés de « consortiums », et qui réalisent aujourd’hui, sous toutes les latitudes, des travaux parfois gigantesques en « cotraitance » ». En effet, de nombreuses entreprises, tentant d’accéder à de nouveaux marchés ou d’acquérir de nouvelles technologies tout en groupant les efforts et en partageant les risques, préfèrent, de plus en plus souvent, mener ensemble des actions concertées, en établissant avec précision les termes d’une coopération qui préserve mieux l’indépendance des participants, tout en leur offrant une structure d’union plus souple dans sa définition et dans son application. Dans ces formules, chaque partenaire s’efforce de sauvegarder ses avantages stratégiques et la possibilité, s’il le désire, de reprendre son autonomie, de coopérer avec d’autres ou de modifier les accords initiaux. Selon la jolie formule du Professeur Le Tourneau, « Une gerbe de contrats naît, dans laquelle chacun conserve son indépendance et n’est responsable que de lui-même (et évidemment de ses préposés), tout en coopérant à un objectif commun ». Certains auteurs soutiennent par ailleurs que rares sont les entreprises qui peuvent agir seules et que pratiquement tous les entrepreneurs ont besoin de s’unir pour prendre un marché ou le réaliser. Le contrat de consortium semble alors l’une des réponses les plus appropriées aux nombreux problèmes que pose la réalisation de grands projets internationaux. Il est défini comme étant « l’acte de nature exclusivement contractuelle, qui regroupe plusieurs personnes, physiques ou morales, qui émettent le désir de travailler ensemble dans le but bien précis de réaliser une œuvre spécifique et unique ». Chacun exécute alors des prestations propres, mais l’opération est commune, le consortium ayant pour objet de déterminer, d’agencer et de gérer une telle coopération. Néanmoins, si de nombreux pays consacrent l’accord de collaboration, leurs approches divergent parfois. On estime que la coopération est un indicateur privilégié de la santé économique d’un Etat, de son degré d’avancement technologique ou encore de son niveau de main d’œuvre. Dès lors, le statut juridique qui est conféré au contrat de coopération prend nécessairement en compte ces données. Le régime de droit adopté se trouve inévitablement influencé par le contexte socio-économique du pays ayant légiféré sur la question. Certes, une tendance se dégage entre les coopérations qui se réalisent sous une forme sociétaire d’une part, et celles qui se réalisent sous une forme exclusivement contractuelle d’autre part. Si le contrat de consortium semble s’éloigner des premières structures de collaboration pour se rapprocher davantage des secondes, il ne saurait pour autant être assimilé à l’une quelconque de ces autres formes de coopération conventionnelles. Mais, la question ne paraît pas aussi nette selon que l’on l’appréhende sous l’approche des pays en développement (Section I) ou sous l’approche des pays développés où le contrat de consortium proprement dit semble avoir une authenticité et une unicité véritables (Section II). La prise en compte de ses deux approches se justifie si l’on admet avec un auteur « […] qu’il existe un fossé technologique entre les deux catégories de pays que nous venons de citer, et que toute coopération […] sera fatalement tributaire de ce fossé ». Section I : Le consortium dans les pays en développement Les pays en développement ont des objectifs sensiblement différents de ceux poursuivis par les pays développés dans le domaine de la coopération entre entreprises. Ainsi, l’appréhension politique de la coopération dans ces pays est très différente (I) et sa traduction juridique apparaît assez originale (II). I- Une appréhension politique différente de la coopération « Les pays non industrialisés, dans leur ensemble, tendent à établir des modes de coopération qui traduisent une volonté politique plus affirmée, plus directive que celles traditionnellement poursuivies par les pays industrialisés ». C’est selon un autre auteur « une coopération de type statutaire ». On estime que ces pays cherchent avant tout à connaître une relative indépendance économique qui pourrait leur assurer le plein emploi d’une main d’œuvre inexpérimentée mais nombreuse et bon marché. La coopération s’avère alors un moyen d’inciter le partenariat avec d’autres Etats ou des entreprises étrangères, source notamment d’entrée de devises et d’embauche. Par ailleurs, en instaurant une collaboration parfois obligatoire avec les entreprises nationales, les Etats d’accueil des investissements peuvent avoir en vue de relancer, maintenir ou créer des secteurs d’activités souvent en gestation ou embryonnaires d’une économie balbutiante. La coopération apparaît ainsi, dans les pays en développement, davantage structurelle que fonctionnelle. Son objectif est alors de mettre en place des structures destinées à créer, soutenir ou consolider un tissu économique fragile et non à permettre à des intérêts privés de réaliser leurs objectifs en fonction de besoins individuels. En outre, la coopération internationale s’avère souvent une nécessité pour ces pays parfois au seuil de l’industrialisation. Le succès d’une telle coopération est lié à des conditions macro et micro-économiques nécessaires, que l’Etat d’accueil doit mettre en œuvre. Ceci passe, comme le soulignait un auteur – constat encore d’actualité – , par une transformation de la structure de l’insertion des économies des pays en développement dans l’économie mondiale et plus particulièrement par la maîtrise par ces pays du processus de formation de capital, de création et d’affectation des richesses. Prenant en compte ces objectifs, de nombreux pays en développement se sont préoccupés de conférer des statuts aux accords de coopération qu’ils décident d’admettre. Ceux-ci se trouvent souvent être, dans la majorité des cas, incontournables et/ou impératifs, réduisant au strict minimum l’initiative individuelle et enfermant la collaboration dans un cadre prédéterminé et précis. Un auteur peut alors, en forçant à peine le trait, affirmer : « On pourrait résumer la situation actuelle des entreprises conjointes dans les différents systèmes économiques par une boutade : dans les pays à économie de marché, tout ce qui n’est pas interdit en matière d’entreprise conjointe, est permis, tandis que dans les pays socialistes et dans les pays en développement, tout ce qui n’est pas permis est interdit ». Ceci se traduit sur le plan juridique par une approche assez originale. II- Une traduction juridique originale de la coopération Le phénomène de coopération se traduit dans les pays en développement par des législations à géométrie variable mais présentant certains traits communs (A). Il s’est matérialisé notamment à travers un développement accru des Joint Ventures (B). A- Des législations à géométrie variable mais à finalité unique La loi est utilisée dans les pays en développement afin de faciliter, d’inciter ou d’autoriser une coopération entre partenaires privés ou publics. Mais, cette utilisation de l’outil législatif se fait différemment : certains pays optent pour des textes spécifiques aux accords de groupement ; d’autres encore fixent des directives moins précises, et certains autres enfin prennent non une réglementation spéciale, mais une réglementation générale s’inscrivant dans le cadre d’une incitation à la coopération. Il se trouve ainsi parfois stipulé dans les législations des pays d’accueil, en particulier celles qui imposent aux entreprises étrangères qui veulent s’implanter sur leur territoire, soit de détenir une position minoritaire, soit de prendre un partenaire local. L’association avec un partenaire local confèrerait une sorte de « légitimation nationale » à un investissement étranger. On observe néanmoins, qu’avec une certaine maturité politique voire même économique, de nombreux pays en développement sont progressivement arrivés à une attitude plus pragmatique quant au plafond de participation étrangère dans la société commune. La tendance actuelle serait, dans ces pays, d’accroître le montant de la participation de l’investisseur étranger au point de la rendre majoritaire. Plusieurs raisons justifieraient cette évolution : d’une part, certains pays prendraient conscience des dangers et des limites d’une direction sans partage, d’une détention majoritaire du capital, d’un contrôle excessif sans association même si par le passé, ces pratiques ont pu « faciliter l’expression et la réalisation des objectifs poursuivis par le pays sous-développé majoritaire » ; d’autre part, il semble que par une formule d’association ou par une participation minoritaire, une partie contractante en développement parviendrait, parfois, à mieux faire valoir ses intérêts ou à se parfaire une capacité de négociation face à un partenaire étranger qui dispose souvent de la maîtrise technologique, organisationnelle, commerciale, financière et autres. De son côté, le partenaire étranger préfèrerait d’autant plus une participation majoritaire pour accroître son pouvoir de gestion et de contrôle que ses engagements financiers sont importants. Pour autant, le partage du pouvoir n’est pas dénué d’intérêt pour lui tout comme pour le partenaire local : il « permet d’obtenir plus rapidement des bénéfices plus élevés. Quand les techniques et la technologie sont effectivement transférées, l’associé peut prendre la direction d’une activité rentable avec plus de confiance ». C’est ce qui a sans doute justifié un certain succès de la joint venture. B- Un développement accru de la Joint Venture Selon une célèbre boutade, la joint venture est « une opération où l’étranger apporte l’argent et l’indigène sa connaissance du pays ; au bout de quelques années, c’est l’indigène qui détient l’argent et l’étranger a appris à connaître le pays ». En effet, cette forme d’investissement réaliserait un compromis entre les aspirations des entreprises privées et celles des pays d’accueil, les premières souhaitant parvenir, de façon concomitante, à un partage des risques et à une situation juridique forte, stable voire durable, les seconds recherchant un accroissement de l’apport financier, humain et technologique de la part des partenaires étrangers, notamment au capital d’entreprises en restructuration ou en privatisation. Cette forme d’investissement fait cependant l’objet de définitions très diverses et très disparates, de sorte qu’il n’ en existe pas d’acception unique et universelle. Selon un auteur en effet, l’ambiguïté originelle de la joint venture en droit américain s’est accrue avec son développement dans la pratique internationale. Aujourd’hui encore, elle n’est pas clairement définie. Selon une conception large, la joint venture désignerait « Toute forme d’association qui implique une collaboration sur plus qu’une période transitoire ». Selon une conception étroite, elle désignerait tantôt l’alliance de deux ou plusieurs entreprises dans une société commune, tantôt une alliance purement contractuelle étrangère à la notion même de société. En réalité, la joint venture serait un instrument de coopération internationale quelle qu’en soit la forme, mais elle serait également un opérateur dès l’instant où elle se présente elle-même sur le marché, généralement avec la personnalité morale. Néanmoins, certaines législations relatives aux investissements étrangers distinguent le caractère sociétaire ou non de la joint venture. A titre d’exemple, la Chine distingue ainsi la « contractual joint venture » qui ne crée pas nécessairement une personne morale d’une « equity joint venture », société sino-étrangère à capitaux mixtes réservée aux activités de production et qui suppose la création d’une personne morale. Certains auteurs affirment que le joint venturing contractuel est caractérisé par une grande souplesse et l’absence de formalisme ce qui, grâce à liberté contractuelle reconnue aux parties, pourrait permettre à celles-ci de « jongler » entre différents droits par le biais de clauses d’electio juris, voire s’en remettre à des règles non étatiques. Il présenterait en contrepartie, « un moindre degré de sécurité juridique », d’autant que les droits nationaux pourraient délibérément limiter la liberté des parties. A l’opposé, l’intérêt du joint venturing sociétaire serait fonction de la marge de manœuvre laissée aux parties contractantes par les textes constitutifs et du degré de sécurité juridique atteint. Ses inconvénients résideraient dans un certain formalisme et dans une certaine rigidité. Quoiqu’il en soit, s’il est à craindre que les statuts des différents pays en développement présentent plus de variantes que de constantes, voire ne désignent des instruments de nature différente, force est de constater que certaines dispositions communes se retrouvent dans les divers textes de loi adoptés. Ces réglementations sont dans la plupart des cas impératives et sectorielles : l’approche de la coopération dans les pays en développement s’en trouve singularisée par rapport à celle observée dans les pays industrialisés. Lire le mémoire complet ==> (L’encadrement contractuel des investissements) Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit Université libre de Bruxelles Sommaire : _____________________________________ A. Brabant, Les marchés publics et privés dans l’U.E. et Outre-Mer, tome II, op. cit., p.348 Valérie Pironon, Les joint ventures – Contribution à l’étude juridique d’un instrument de coopération internationale, Paris, Dalloz, 2004, p.3. André Brabant, op. cit., p. 302. Charles-Henry Chenut, Le contrat de consortium, Paris, LGDJ, 2003, p. 3. Alexis Jacquemin, « Coopération entre les entreprises et droit économique », in Coopération entre entreprises – Entreprises conjointes, stratégies industrielles et pouvoirs publics, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1988, p.18. Philippe Le Tourneau, « Ingénierie et transfert de maîtrise industrielle – Réalisation », in Juriscl. Contrats de distribution, Fasc.1830, 2000, p.27. F. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Paris,Précis Dalloz, 6ème éd., 2002, n°889, p.825. Le métro de Pékin, le tunnel sous la Manche, la réhabilitation du centre de Beyrouth, l’édification de barrages et de centrales en Inde, en Chine en Turquie ou au Pakistan entre autres grands projets sont souvent cités. Pour les références précises de ces projets V. Pierre-Henri Ganem, « Financement de projets internationaux », in RDAI, 1996, pp. 926 et s. ; RDAI, 1997, pp. 259 et s. ; RDAI, 1998, pp. 123 et s. ; V. aussi, André Brabant, op. cit., pp. 299-301. Charles-Henry Chenut, Le contrat de consortium, op. cit., p.3 Ibidem Ibidem p.72. En ce sens, A. Prévisani, « Les caractères juridiques principaux des statuts légaux de coopération », in DPCI, 1984, p.337. Charles-Henry Chenut, op. cit., p. 10. Sur les coopérations purement contractuelles, V. Michel Dubisson, Les accords de coopération dans le commerce international, Paris, Lamy S.A., 1989, pp.47-71. Cet auteur semble cependant considérer la coopération dans laquelle les parties décident de constituer une entité commune dotée de la personnalité juridique, non comme une coopération sociétaire mais, comme une « coopération de type mixte » : V. ouvrage précité, pp. 72-101 et précisément, n°101, p.72. Sur la distinction d’avec ces autres contrats de coopération V. Infra Section 2 , II, A. A. Prévisani, op. cit., p. 337. Charles-Henry Chenut, op. cit., p. 77. Michel Dubisson, Les accords de coopération dans le commerce international, op. cit., pp 102-111 et précisément, n° 164, p.102. Sur les attitudes pouvant être adoptées par l’Etat d’accueil, V. Joseph Jehl, « Régimes juridiques de la création des entreprises conjointes : analyse de droit comparé » in, Coopération entre entreprises – Entreprises conjointes, stratégies industrielles et pouvoirs publics, op. cit., pp. 121-132. Charles-Henry Chenut, op. cit., p. 78 ; A. Prévisani, op. cit., p. 339 Charles-Henry Chenut, op. cit., p. 78. Bernard Snoy, « Entreprises conjointes et coopération Nord-Sud – Expérience de la Banque Mondiale », in Coopération entre entreprises – Entreprises conjointes, stratégies industrielles et pouvoirs publics, op. cit., pp. 147-151. Charles Valy Tuho, « Entreprises conjointes et coopération Nord-Sud », in Coopération entre entreprises – Entreprises conjointes, stratégies industrielles et pouvoirs publics, op. cit., pp. 157-158. Contra : Philippe Fouchard dans la préface de l’ouvrage de Valérie Pironon op. cit., p. XV. Pour ce dernier, la libéralisation des économies planifiées et de celles des pays en voie de développement a entraîné l’accueil de l’investissement étranger et a conduit à l’abandon progressif de ces statuts impératifs. Il relève cependant que quelques pays dont la Chine et le Vietnam on conservé, en les assouplissant, des réglementations spécifiques et impératives, qui organisent des joint ventures sous deux formes : la société mixte, dotée de la personnalité morale, et l’entreprise conjointe, qui est purement contractuelle. Bernard Remiche, conclusions, in Coopération entre entreprises – Entreprises conjointes, stratégies industrielles et pouvoirs publics, op. cit., p.286. Sur les pays et les options prises par leurs législateurs, V. Charles-Henry Chenut, op. cit., pp. 78-79. Sur les pays et leurs exigences et pour des textes en vigueur au 30 juin 1999, V. Corinne Vadcar, « Problématique et définition de l’investissement direct étranger en droits national et international », in Jurisclasseur dr. int., 1999, Fasc. 565-50, p. 4. J. Calvo, « La pratique internationale des joint ventures », Petites affiches, 16 mars 1990, p. 17 cité par Valérie Pironon, op. cit., p.3. Corinne Vadcar, op. cit., pp. 4-5. Pour Ch. Oman, de nombreux pays d’accueils ont constaté que la détention de la majorité du capital par les intérêts locaux ne leur assurent pas la maîtrise effective de l’opération, de même que de nombreux investisseurs se sont rendus compte qu’une participation minoritaire, ou même nulle, ne signifie pas nécessairement, de leur point de vue, un droit de regard insuffisant sur l’opération : Charles Oman, Les nouvelles formes d’investissement dans les industries des pays en développement : industries extractives, pétrochimie, automobile, textile, agro-alimentaire, Paris, OCDE, 1989, p.19-20. Un auteur, appréciant la politique contractuelle par rapport à la politique d’association, affirme que dans une association en capital, la récupération du pouvoir de décision ne peut se faire, la plupart du temps, qu’à la suite d’un conflit où le partenaire étranger est obligé d’abandonner ses positions dans l’association. Pour lui, les entreprises conjointes seraient plus opportunes dans le domaine industriel ou commercial, comme vecteur de technologie, alors que le secteur minier devrait recourir, de plus en plus, à la coopération contractuelle, seule moyen d’assurer la volonté farouche de souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles : Charles Leben, « Les modes de coopération entre pays en développement et entreprises multinationales dans le secteur de la production des matières premières minérales », in JDI, 1980, op. cit., p. 596-597. L’affirmation est de M. Benchikh, Droit international du sous-développement – Nouvel ordre dans la dépendance, Paris, Berger-Levrault, 1983, p. 140, cité par Corinne Vadcar, op. cit., p. 5. Ibidem p.5 où l’auteur reprend reprend et commente une liste de pays dans lesquels les législations autorisent une position étrangère majoritaire. ACP-CEE, Guide du partenariat dans l’industrie, Bruxelles, Centre pour le Développement Industriel, 1988, p. 6, cité par C. Vadcar, op. cit., p.5 ; Adde, Ch. Oman, op. cit., p. 20 pour qui un nombre croissant d’entreprises constatent qu’elles peuvent obtenir des revenus intéressants de certains de leurs actifs corporels ou incorporels – technologies, capacités de gestion ou de commercialisation sur les marchés internationaux, par exemple – sans avoir pour autant à détenir la propriété ou à assurer le financement de projets d’investissement dans des pays en développement. V. également les dispositions de l’Accord de Partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, notamment la 4ème partie « Coopération pour le financement du développement » et précisément le Chapitre 7 « Appui aux investissements et au développement du secteur privé ». André Gracia, « L’investissement à l’étranger et la pratique des joint ventures », in Les Joint Ventures internationales de Klaus Langefeld-Wirth, Paris, GLN Joly, 1992, p. 8. En ce sens, Corinne Vadcar, op. cit., p. 7. Ibidem Sur l’émergence de cette « notion ambiguë » dans la common law nord-américaine, V. Valérie Pironon, Les joint ventures – Contribution à l’étude juridique d’un instrument de coopération internationale, op. cit., pp. 11-26. P. Fouchard résume assez bien cette ambiguïté lorsqu’il affirme : « Qu’est ce qu’une joint venture ? Même les Américains, qui ont développé le concept et sa pratique, ne peuvent le dire avec précision. Pour la double raison qu’ils ne l’ont jamais clairement distinguée du partnership et qu’ils ont finalement admis qu’elle pouvait être une véritable société (joint venture corporation) » : P. Fouchard, préface à l’ouvrage de Valérie Pironon précité, pp. XIII-XIV. Valérie Pironon, op. cit., p. 34. Luis O. Baptista et P. Durand-Barthez, Les associations d’entreprises (Joint Ventures) dans le commerce international, Paris, Feduci/LGDJ, 1986, p.44. André Garcia, op. cit., p. 8. Sur le montage d’une Joint Venture, V. la « Check List » proposée par Francis Meuret, Naissance et vie d’une Joint Venture, Bruxelles, Feduci/Bruylant, 2005, pp. 7 et s. ; V. également Michael R. Horten et philippe Sarrailhé, Les Joint-Ventures franco-américaines (Aspects juridiques et fiscaux de l’établissement d’une filiale commune aux U.S.A.), Bruxelles, Larcier, 1994, pp. 1-67 ; Klaus Langefeld-Wirth, « Analyse pratique de la Joint Venture internationale », in Joint Ventures internationales, op. cit., pp 21 et s. ; The United Nations, Joint Ventures as a form of Economic Cooperation, New York, Taylor & Francis, 1989, pp. 13 et s. Valérie Pironon, op. cit., p. 34. Cet auteur estime que l’on ne saurait retenir une conception étroite attachée à la forme contractuelle ou sociétaire de la joint venture et que la conception large doit également être écartée, car la joint venture est une opération de coopération dans une entreprise déterminée organisée par un montage, description qui n’embrasse pas tous les contrats de coopération. Dans le même sens, P. Fouchard dans la préface à l’ouvrage de Valérie Pironon op. cit., p. XIV. Loi du 13 avril 1988, désormais remplacée par la loi du 31 octobre 2000, citée par Valérie Pironon, op. cit., p.330 et les références citées. Valérie Pironon, op. cit., p. 255. Corinne Vadcar, op. cit., p. 8 et la référence citée par l’auteur. Valérie Pironon, op. cit., p. 255. Sur les limitations à la liberté des parties en général, V. M. Dubisson, op. cit. pp. 115-141 ; Dominique Michel, « L’entreprise commune : un instrument de coopération « sensible » en matière de concurrence », in La coopération entre entreprises, Bruxelles/Antwerpen, Bruylant/Kluwer, 1993, pp. 185-207. Corinne Vadcar, op. cit., p. 8. En ce sens, Charles-Henry Chenut, op. cit., p. 79
Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’encadrement contractuel des investissements
L’encadrement contractuel des investissements
Université 🏫: Université Libre de Bruxelles - Mémoire du diplôme d’études approfondies en droit
Auteur·trice·s 🎓:
Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI
Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI
Année de soutenance 📅:
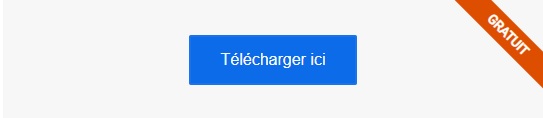
Si le bouton de téléchargement ne répond pas, vous pouvez télécharger ce mémoire en PDF à partir cette formule ici.